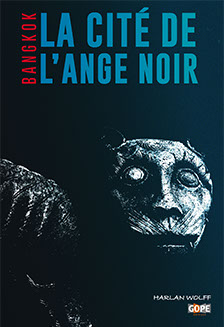
À Bangkok, un tueur en série enlève des jeunes filles et se livre à un abominable rituel sadique. Les autorités n’ont aucun indice.
Carl Engel est une énigme, même pour ses proches. Pendant trente ans, ce Londonien au caractère entier a réussi à se forger une carrière de détective privé malgré les soubresauts de la vie politique thaïlandaise. Luttant contre le vieillissement, l’alcoolisme et une charge de travail décroissante, il est contacté par un Américain âgé qui, moyennant un cachet exceptionnellement élevé, le charge de retrouver son frère disparu.
L’enquête nous fait descendre dans le monde sordide du tueur en série et dans les bas-fonds de Bangkok, avec un petit détour par les tables de jeux de Macao, sur fond de luttes de pouvoir remontant à la guerre du Vietnam.
Assisté d’amis fidèles (ex-CIA, journaliste, chauffeur de taxi, colonel et quelques figures du monde interlope des bars de nuit), Carl aura pour seule priorité de rester en vie et de débusquer le tueur.
Harlan Wolff vit en Thaïlande depuis 1977. Pendant une vingtaine d’années, il a été détective privé et médiateur et a résolu des affaires de vols, de meurtres, d’enlèvements et d’espionnage industriel.
Dès sa plus jeune enfance, Harlan voulait être écrivain et, trouvant dans son expérience personnelle hors du commun un matériau littéraire riche, il nous apporte la preuve d’un réel talent avec ce premier roman.
Prologue
« Nous, les tueurs en série, nous sommes vos fils, nous sommes vos maris, et nous sommes partout. Et il y aura d’autres morts parmi vos enfants demain. »
Ted Bundy
La Chevauchée des Walkyries emplissait l’intérieur de sa voiture et flottait autour de la carrosserie telle une brume sonore. Il avait recouvré son statut de dieu, ce qui le rendait attentif à chaque note magnifique de Wagner jouée à plein volume. Seul Wagner avait assez de puissance et suffisamment de profondeur métaphysique pour les oreilles des dieux tout en instillant la terreur nécessaire chez les mortels.
Sa nouvelle Mercédès noire rutilante fonçait et bondissait sur la route sale et pleine d’ornières, soulevant un nuage de poussière dans son sillage. D’habitude, le vieil homme ne conduisait pas si vite mais son retard l’agaçait et le soleil n’allait pas tarder à se lever. Il maudit ces pauvres fermiers si gênants qui partaient à pied rejoindre leurs champs à cette heure indue. En vieillissant, il péchait par négligence. Il ne s’était jamais laissé de marge si étroite auparavant et une chose était certaine, jamais plus il n’attendrait le dernier moment. Il lui fallait tolérer la poussière et les gravillons que ses roues, en tournant, faisaient voler. Les petites pierres allaient laisser des marques sur la peinture parfaitement lustrée et cela le contrariait. Sa Mercédès était sa fierté.
Il avait quitté la grande route quelque part après la ville historique d’Ayutthaya. Il n’était pas tout à fait certain de savoir où il se trouvait, mais il serait capable de revenir sur la route principale, ce qui était l’essentiel. Il conduisait le dos droit comme un piquet et le visage tendu vers l’avant pour mieux voir à travers les minuscules trouées dans le brouillard rouge formé par la poussière de latérite. Sur sa gauche, il repéra un chemin qui longeait un canal d’irrigation à sec et menait à un champ apparemment négligé et non cultivé. Il faudrait que cela fasse l’affaire, alors il tourna à gauche et parcourut quelque deux cents mètres jusqu’à ce qu’il ne vît plus personne dans son rétroviseur. Il arrêta la voiture près du fossé. Il respirait vite et sentait son cœur battre. C’était là sa raison de vivre.
Il sortit du véhicule et alla ouvrir le coffre. Elle était parfaite, pensa-t-il, et maintenant, elle était sienne à jamais ; personne d’autre ne pourrait la posséder. Elle semblait jeune et peut-être l’était-elle. Avec les Thaïlandaises, c’était difficile à dire. Du cou au sommet du crâne, elle n’avait aucune trace de meurtrissure. Ses longs cheveux noirs et brillants couvraient les béances ensanglantées où ses oreilles avaient tenu leur place et elle avait conservé un visage d’ange. Du cou vers le bas, son torse nu, fracassé et tailladé, était couvert de sang. Mon Dieu que tu es belle, pensa-t-il en soulevant prestement le petit corps du coffre tapissé d’une bâche fixée avec du ruban adhésif toilé. Il le transporta dans le fossé pour le nettoyage rituel et l’allongea doucement sur un lit de feuilles brunes.
Ensuite, avec une agilité trompeuse pour son âge, il remonta sur le chemin d’un bond et alla chercher un sac de supermarché en plastique dans le coffre ensanglanté. En toute hâte, il sortit plusieurs bouteilles à bière du sac, en ôta les bouchons et fit couler l’essence sur tout le corps, d’une extrémité à l’autre. En temps normal, il ne se serait pas pressé mais aujourd’hui, c’était différent. Il attrapa un journal sur le siège passager avant, le roula, y mit le feu avec une allumette et le laissa tomber dans le fossé sans plus de cérémonie.
Lorsque la police finit par réagir aux appels téléphoniques et arriva sur les lieux, les fermiers du coin étaient groupés autour des restes noircis et fumants et prenaient des photos avec leurs téléphones d’occasion rafistolés avec du scotch, de la colle et des élastiques de couleurs vives. Tout ce que les fermiers prétendaient avoir vu se résumait à un nuage de poussière s’éloignant d’eux à vive allure pour rejoindre la grande route menant à Bangkok.
Un habitant du village, souriant, aux dents écartées et au visage parcheminé, circulant sur une bicyclette rouillée, dit aux flics qu’il était sûr que la voiture était une Mercédès Classe S flambant neuve conduite par un étranger d’un certain âge et faisant un tel boucan qu’on l’aurait crue emplie de fantômes hurlants. La police le traita de fou et écarta sa déclaration en la prenant pour le radotage d’un campagnard inculte. Tout un chacun savait bien que les étrangers d’un certain âge roulant dans des voitures d’un prix ridiculement exorbitant ne se débarrassaient pas d’un corps dans la campagne thaïlandaise à 5 heures du matin.
Chapitre 1
« Les démons me protégeaient. Je n’avais rien à craindre de la police. »
David Berkowitz
Un autre lundi de mousson s’était écoulé et Sukhumvit Road, l’artère multicolore où s’alcoolisaient les expatriés, était envahie par des eaux nauséabondes. Carl Engel, le détective privé le plus résigné de Bangkok, s’était abrité de la tempête dans une petite rue, après avoir garé sa voiture près de la route principale. Voilà sept semaines qu’il n’avait pas eu un seul client et il avait été contraint de vendre un jeu d’échecs hongkongais en ivoire, sculpté à la main, que lui avait offert son père, décédé depuis longtemps. Cette vente lui avait procuré suffisamment de trésorerie pour tenir deux ou trois mois et avait temporairement apaisé sa crainte de sombrer dans la pauvreté. Se retrouver fauché était la seule chose qui fichait encore la trouille à Carl. La mort lui avait tapoté l’épaule un nombre suffisant de fois pour lui permettre d’acquérir un certain niveau d’immunité, mais Bangkok était le dernier endroit où vivre pour un étranger sans le sou.
Il était parti de son domicile tôt et avait eu la chance de ne pas tomber en panne et de ne pas se faire piéger par les eaux en crue. Il interpréta ces signes comme une récompense : il avait fait fi de son pessimisme habituel et envisagé la possibilité de transformer le client potentiel inattendu du jour, une espèce en danger, en une injection de cash hautement nécessaire. Son matinal début de journée lui avait laissé du temps à tuer, ainsi qu’une impatience de plus en plus difficile à contenir pour son rendez-vous avec sa plus récente opportunité. Puisque les regards furieux qu’il jetait à la pendule ne faisaient pas avancer les aiguilles plus vite, il cessa, puis se surprit rapidement à regarder sa montre.
Les eaux avaient atteint le bas des portières de sa Porsche rouge, une antiquité millésimée 1977, véhicule peu pratique dans les meilleures circonstances. Ce modèle d’une trentaine d’années se révélait impossible pendant la mousson. Les femmes étaient entrées dans sa vie et en étaient sorties, mais cette voiture y était restée. Il regardait la vieille Porsche par la fenêtre du Duke’s American Bar and Restaurant, l’un des rares endroits ouverts assez tôt pour le petit déjeuner. Il avait plu fort, comme buffle qui pisse, voire comme éléphant qui pisse. Heureusement, l’entrée du Duke’s était suffisamment haute pour maintenir l’eau à distance. Quoi qu’il se passe dehors, les affaires marcheraient comme d’habitude et, en cas d’urgence, il y avait à l’étage une guesthouse offrant quelques chambres bon marché.
Carl avait vécu dans cette guesthouse autrefois et Duke’s était devenu sa résidence pendant quelques mois après l’implosion de l’un de ses mariages – période de femmes faciles, de beuveries et de parties de poker, le tout s’étant terminé de façon abrupte lorsque les cartes cessèrent de lui être favorables. Une introspection s’ensuivit, qui offrait tout le confort d’une descente dans un égout à bord d’un bateau à fond de verre, elle-même suivie d’un vigoureux récurage et brossage alors qu’il retrouvait le monde où l’on gagne de l’argent situé aux antipodes de celui où on le dépense.
Carl Engel avait les cheveux poivre et sel. Il arborait une taille et une corpulence légèrement supérieures à la moyenne. Chaque année depuis son quarantième anniversaire avait vu son ventre grossir et il lui fallait combattre une décennie d’épaississement. Sa grande taille l’avait aidé à compenser le surpoids, mais maintenant qu’il avait atteint la cinquantaine, sa bedaine commençait à faire la loi.
Il aimait les vêtements italiens coûteux sans frimer pour autant. Ce jour-là, il portait un jean, un polo noir et une veste sport en lin gris qui se froissait sur lui. Pour compléter son look, il s’était chaussé de mocassins noirs en cuir souple sans mettre de socquettes. Au poignet, il arborait un chronographe Girard-Perregaux. Il s’agissait d’une montre de valeur qui avait – on ne sait trop comment – réussi à échapper à la mise en gage et traversé toutes les vicissitudes de son existence sans quitter son poignet. Il choisissait de paraître chic et prospère pour camoufler la nature fluctuante de ses finances. Il avait le visage clairement marqué par le temps, mais avait conservé dans son regard bleu pâle l’étincelle d’un homme invaincu.
Au cours de sa jeunesse, Carl avait eu la chance d’expérimenter tout ce que la Thaïlande pouvait offrir. Jadis, il avait même fait preuve d’un romantisme idéaliste auquel son travail avait rapidement mis fin. Carl avait vu le meilleur et le pire chez les gens, le pire surtout. Grâce à l’expérience, il en avait conclu que personne ne connaissait jamais vraiment personne, étant donné que chacun renfermait invariablement une part d’inconnu, réservée exclusivement à d’autres êtres humains ou à d’autres situations. Il avait la faculté de pénétrer les âmes plus profondément que bien d’autres et il en concluait que, sous les apparences, existait cette dualité. Carl en était arrivé à croire que l’amour exigeait de mettre l’autre sur un piédestal et il ne pouvait plus s’y résoudre.
Sa relation avec le Duke’s American Bar and Restaurant durait depuis plus de trente ans et il aimait bien y faire un tour de temps à autre pour s’abreuver de nostalgie. Au fil des années, Carl avait vu défiler bien des clients. Certains étaient partis les pieds devant, d’autres étaient partis prendre l’avion. Des photos 20 x 25 décolorées d’un Carl jeune posant avec quelques-uns d’entre eux tapissaient les murs. Il avait toujours pensé que c’était une chance que très peu de gens prennent le temps de regarder ces photos où son visage jeune, souriant et ouvertement optimiste, s’affichait à côté de personnes disparues de longue date. Curieusement, il s’attendait toujours à voir ceux qui étaient morts franchir le seuil de la porte un beau jour. Ceux qui étaient rentrés en avion finiraient bien par repasser la porte. Bangkok produisait cet effet-là sur les gens : ils revenaient à coup sûr.
Carl était assis, seul, à une table ronde entourée de huit chaises en bois. Elle avait d’abord servi de table de poker puis avait obtenu la place d’honneur dans un go-go bar de Patpong tenu par des Texans arborant des chapeaux de cow-boy. Il était illégal de jouer au poker ou à tout autre jeu d’argent non contrôlé par le Gouvernement, alors les propriétaires expédiaient les filles vêtues de bikinis chez elles, fermaient les portes à clé à 1 heure du matin et jouaient aux cartes jusqu’au lever du soleil. […]
Chapitre 2
Toute sa vie, Carl avait vécu d’expédients. Les gens le percevaient généralement comme quelqu’un de sincère, peut-être parce qu’il essayait de l’être quand la vie ne l’en empêchait pas. Son plus grand atout résidait dans sa faculté de transformer leur confiance en revenus non imposables. Il ne pouvait pas vivre de l’air du temps et il avait des goûts de luxe.
L’hôtel Sukhumvit Grande, un cinq-étoiles, avait pris une place importante dans la vie professionnelle de Carl. C’était de là qu’il dirigeait ses affaires et, d’ordinaire, il y passait au moins deux jours par semaine. Les clients de Carl étaient plus impressionnés de le voir traité en VIP dans un hôtel cinq étoiles qu’ils ne l’auraient été par un petit bureau dans une ruelle de Bangkok. Alors, au fil des ans, il avait noué des relations amicales avec le personnel et se sentait chez lui.
Il n’était pas revenu au Sukhumvit Grande depuis deux ou trois mois, avant sa disette financière, à l’occasion d’une réunion compliquée qu’il avait organisée avec quatre colonels de la police au sujet de l’interprétation que les forces de l’ordre thaïlandaises faisaient des lois et de leur attitude envers les hommes d’affaires étrangers louches, des criminels en col blanc qui payaient Carl sans sourciller pour leur fournir ces renseignements. Carl était en plein milieu de la réunion quand Fritz Freysinger, le directeur de l’hôtel, un Suisse de grande taille vêtu comme un entrepreneur de pompes funèbres, arrivé à Bangkok assez récemment et d’une efficacité tout aseptisée, montra qu’il désapprouvait l’influence que Carl exerçait sur le personnel de l’établissement.
Le conflit entre eux était la faute de Carl. Il participait à un cocktail donné dans la salle de bal de l’hôtel lorsque le directeur s’était approché de lui pour lui présenter un ami allemand.
— Je vous présente mon ami Graf Felix von Gorbitz, un authentique comte.
Carl toisa ledit comte de la tête aux pieds puis se tourna vers le directeur et lui répondit :
— Désolé d’apprendre cette triste nouvelle. Toutefois, je vous admire d’être capable de supporter sa compagnie.
Depuis ce jour-là, Freysinger lui en voulait et le jour où Carl discutait avec les colonels lui fournit une occasion de se venger ; le directeur s’approcha donc et dit :
— C’est un joli bureau que vous avez là, espérant le démasquer et l’embarrasser.
— Et bon marché ! lui rétorqua Carl.
Il savait exactement ce que voulait dire Carl. Prendre cinq cafés sous des chandeliers en cristal coûterait l’équivalent de quarante dollars américains. C’était beaucoup plus impressionnant et infiniment moins cher que de louer un vrai bureau. Le bel hôtel de Herr Freysinger avait été qualifié de « bon marché », alors il opta pour la neutralité et s’éloigna précipitamment. Carl n’avait nullement besoin de lui. Dans la mesure où il offrait de généreux pourboires au personnel, cet hôtel était le sien. Cent bahts distribués à quelques personnes clés lui permettaient de tout maîtriser, du parking jusqu’aux bars-buffets. Si cela déplaisait au directeur, il n’y avait pas de problème. Le directeur ne figurait pas sur la liste des gens auxquels il donnait cent bahts et s’il ne mettait pas fin à ses sarcasmes, Carl le rayerait aussi de la liste de Noël.
Carl descendit les jambes de son pantalon, rechaussa ses pieds mouillés et parcourut le hall du regard. Il aimait bien identifier la personne qu’il allait rencontrer avant qu’elle ne signale sa présence. Son client potentiel était sous le coup de la surprise et cela procurait à Carl un avantage nécessaire. Il était à la recherche de cette tension provoquée par l’anticipation de la confession à venir.
Les clients le contactaient quand quelque chose était allé complètement de travers dans leur vie. Quelque chose qu’ils avaient tenté de régler eux-mêmes sans y parvenir. Alors, avant de discuter d’un plan d’action, ils éprouvent le besoin d’expliquer comment ils en sont arrivés là tout en évitant de paraître idiots. Il s’agissait donc bien d’une confession et c’est pourquoi Carl guettait une personne tendue et probablement plus qu’un peu nerveuse.
Carl repéra immédiatement le client potentiel. Il ressemblait à un collégien surdimensionné attendant d’être reçu par le chef d’établissement. Il pesait au moins cent cinquante kilos et, à l’instar de tant de touristes étrangers visitant les tropiques, il portait un bermuda et un polo. Son ventre débordait par-dessus sa ceinture et ses grosses jambes enflées saillaient de son bermuda en coton, telles les créations d’une machine à faire les saucisses devenue folle. Ses joues bouffies et son gros nez étaient tout rouges suite à des années d’alcoolisation et à la fatigue occasionnée par le fait de respirer l’air chaud et humide des tropiques. Son front était dégarni et le sommet de son crâne chauve, mais il gardait les quelques cheveux qu’il lui restait sur les côtés suffisamment longs pour en recouvrir le haut de sa tête, comme une serpillière jetée là au hasard. Il avait achevé cette création artistique en se teignant les cheveux en noir de jais. Le résultat n’était pas beau à voir.
Carl trouvait que cet homme ressemblait à un clown démesuré, toutefois il arborait une Rolex au poignet et une bague de diamants au doigt, donc tout espoir n’était pas perdu. Carl se dirigea vers lui et se fit connaître. L’homme ne cacha pas sa surprise de voir Carl l’identifier sans avoir eu le moindre indice. Carl haussa les épaules pour donner l’impression qu’il s’agissait d’un simple tour de magie à ne pas prendre au sérieux. Il se présenta et suggéra d’aller à l’étage, dans la bibliothèque, où ils seraient plus tranquilles. Ils empruntèrent l’escalier très décoré, au centre du hall.
Carl monta les marches lentement pour ne pas mettre dans l’embarras le mastodonte qui faisait office de client potentiel. Ils finirent par atteindre la bibliothèque sans que l’obèse eût besoin de réanimation par bouche-à-bouche, ce qui était plutôt une bonne chose ; en effet, Carl avait décidé que si le client potentiel s’effondrait au milieu de l’escalier, il attendrait de l’aide et que si personne ne venait à son secours, il le laisserait mourir. Même les enquêteurs privés de Bangkok ne peuvent pas faire l’impossible pour un client et cet obèse hideux n’était qu’un client potentiel. […]
Chapitre 7
[…] Carl emporta l’ordinateur dans le bureau climatisé et effectua sur Google une recherche approfondie concernant les vieilles histoires relatées sur les journaux. L’une d’elles racontait que la police interrogeait des étudiants pour localiser l’ex-copain de la dernière victime, leur principal suspect. La police n’avait pas pris en compte le fait que nombre d’étudiantes travaillant au noir comme hôtesses ou masseuses se livraient à la prostitution pour mener une vie normale, sur le plan pécuniaire.
Carl présuma que la police savait pertinemment que beaucoup d’étudiantes vendaient leurs charmes. Qu’ils l’aient ignoré l’aurait choqué. La plupart des policiers qu’il avait rencontrés au fil des années avaient couché avec un nombre suffisant d’entre elles. Malheureusement, si le choix consistait à se retrouver devant un meurtre non élucidé ou à admettre l’existence d’une industrie de cette nature en Thaïlande, alors la décision était réglée d’avance. La Thaïlande n’avait pas l’habitude de soulever la soie brillante qui recouvrait son bas-ventre ni d’autoriser le moindre coup d’œil furtif à l’eczéma qui s’y cachait.
Ensuite, Carl tapa le nom de Somchaï Poochokdee. Aucune photo n’apparaissait, ce qui ne le surprit pas. Il tomba sur quelques communiqués de presse faisant état de marchés immobiliers en pleine expansion et de dons à des œuvres d’intérêt public. Cette description d’un homme d’affaires était tellement superficielle qu’elle en devenait agaçante. Il trouva un élément positif : un article professionnel incluant l’adresse de son bureau (Carl l’avait déjà) et son numéro de téléphone mobile (Carl ne l’avait pas).
Immédiatement, Carl envoya un message au colonel lui demandant l’historique des factures correspondant à ce numéro de téléphone. Ceci allait prendre quelques jours : la police devrait adresser par écrit une requête officielle à la compagnie de télécommunications avant qu’elle n’accepte de donner l’information. Il lui envoya ensuite un autre message suggérant une rencontre au club, à minuit. Il ne proposa pas une heure moins tardive, car personne ne s’y rendait tôt.
George était entré dans la maison par la porte du rez-de-chaussée : c’était là que se trouvaient la cuisine, la machine à café et la bonne. La bonne aimait bien George, alors il montait toujours au deuxième étage un expresso à la main. Carl avait remarqué que le café de George était toujours couronné à souhait d’une mousse brune, contrairement à tous ceux qu’elle lui servait. Il s’assit dans le fauteuil près de la table de travail de Carl, dans le petit bureau, et but son expresso à petites gorgées. Il montra du doigt une photo 20 x 25 posée sur l’étagère derrière la chaise de Carl. La photo était montée dans un cadre en bois d’excellente qualité. C’était l’œuvre d’un professionnel et elle représentait une femme noire séduisante, debout devant un piano à queue, chantant dans un micro.
— Comment ça va de ce côté-là ? demanda George.
— Pas terrible. J’appelle cette photo Bye Bye Blackbird.
— Tu n’aurais pas envie qu’elle t’entende dire ça, lui dit George.
— C’est bien ça le problème.
— Tu crois que ça n’a pas marché parce qu’elle est noire ?
— Non, ce n’est pas ça. La raison pour laquelle ça n’a pas fonctionné, c’est qu’elle est américaine.
— Alors, tu es toujours contre le politiquement correct ?
— Bien sûr, c’est de la frime. La fausse politesse n’est pas flatteuse, elle est condescendante. Si une personne noire entrait ici, maintenant, serions-nous censés contrôler notre conversation ? Si oui, George, nous deviendrions racistes par défaut.
— C’est l’Amérique, Carl. C’est leur façon d’être.
— Je ne suis pas obligé de me conduire comme ça et une chose est certaine, je ne suis pas obligé d’être d’accord avec ça.
— Bye Bye Blackbird est plutôt drôle, en fait, dit George en souriant.
— Ce serait encore plus drôle s’il n’y avait pas besoin de faire des analyses dans tous les sens avant d’oser formuler cette opinion.
— Elle te manque ? demanda George.
Carl ne répondit pas.
Carl l’informa des derniers détails sur l’affaire et de ses récents développements. George le mit au courant de ses informations sur les agents de la CIA au Vietnam, lesquelles étaient abondantes. Il dit en avoir rencontré de bons. Il les appelait « L’équipe de rêve de l’Amérique », eu égard à leur niveau d’études élevé et à leurs croyances fortes. Il parla aussi d’une catégorie différente. Des hommes qui avaient transformé le rêve américain en cauchemar :
— C’étaient les corrompus guidant les corrompus. Des fanatiques œuvrant pour une Amérique chrétienne impériale dans le seul but de faire beaucoup d’argent, pour eux-mêmes et pour les sociétés américaines.
George embrassa du regard les vieux livres, les peintures à l’huile, les tapis persans usagés, les haut-parleurs gros comme des garde-robes et l’ampli datant de la révolution industrielle. Il plissa les yeux et eut l’air gêné, puis regarda la femme de la photo et dit :
— Elle me demandait toujours pourquoi tu t’entourais de vieilles choses. Moi aussi, je me suis posé des questions sur ton addiction à la nostalgie.
Carl réfléchit quelques instants puis répondit :
— Ma théorie, à garder pour toi, c’est que lorsqu’un homme ne sait pas qui il est, alors il repart vers l’époque où il croit qu’il le savait.
— Si l’on s’en tenait à ce bureau, cela ferait de toi un super-centenaire.
— J’espère que tu ne prêtes pas l’oreille à la théorie de la réincarnation prônée par la bonne. Elle pense que je suis un trou-du-cul ressuscité.
George sourit, termina son café et franchit la porte du salon en direction du secteur de la piscine. Carl passa le reste de la journée à écouter de la musique et à lire l’histoire de Beyrouth. Récemment, il n’écoutait que de la musique classique car sa passion pour le jazz s’était éteinte. […]
Chapitre 8
[…]
— Je ne me suis jamais autant amusé, mon vieux. S’ils mettent la main dessus, je suis dans une merde pas possible.
Carl l’observa un instant et lui demanda :
— Qu’entends-tu par « je suis dans une merde pas possible » ?
— Hé, mon vieux, tout le monde est terrifié et aucune des nanas ici ne veut partir avec un inconnu. Elles me connaissent toutes. Je ne me suis jamais fait autant de meufs de toute ma vie, mon vieux. Elles font la queue dans l’espoir d’avoir une chance de m’offrir un verre ou de me glisser une ecsta.
Carl rit.
— Jamais vu les choses sous cet angle-là !
— Ça m’a vachement surpris aussi, j’ai pas envie que ça s’arrête, c’est certain. Comprends-moi bien, Carl. Je continue à souhaiter qu’ils l’attrapent. Tu vois ce que je veux dire, hein ?
— Bien sûr, Eddie, je comprends très bien ce que tu veux dire. Si tu essaies de les rendre toutes heureuses, attention au mélange coca et Viagra. Tu te rappelles ce qui est arrivé à Gianni ?
— Oui, je m’en souviens. Sacré Gianni. Il n’avait que 33 ans.
Tout en parlant à Carl, il avait suivi l’enchaînement de la musique et il traversa à toute vitesse la piste de danse bondée pour atteindre la cabine du DJ. Il regagnait toujours ses platines à temps pour éviter un silence embarrassant.
Carl prit son verre et se mit à faire le tour de la salle du regard. Elle l’avait repéré avant qu’il ne l’ait remarquée, elle, debout dans un coin surélevé parmi les gens magnifiques. Elle était en train de regarder Carl lorsqu’il la vit à travers la forêt des têtes de la foule. Elle s’appelait June et elle était cadre en marketing dans l’un des hôtels cinq étoiles de la Capitale, ce qui signifie qu’elle passait le plus clair de sa journée de travail au Starbucks à bavarder avec ses amies autour d’un café. À l’instar de nombreuses femmes belles, elle manquait totalement de confiance en elle, même si cela ne se devinait nullement en la regardant.
Carl la connaissait sans vêtements sur elle et les gens disent des choses lorsqu’ils sont nus et qu’il est 3 heures du matin. En Thaïlande, il n’est pas rare que les femmes aient subi des sévices sexuels en grandissant. On prétend que pas moins de la moitié des Thaïlandaises ont été victimes de viols ou d’abus sexuels. Cette société est fondée sur des strates hiérarchiques et les rapports de force, voire la brutalité, sont vraiment la norme. June avait sa part, injustement copieuse, de sombres secrets. La dynamique de la violence sexuelle fonctionne sur le besoin qu’éprouve la victime de dissimuler ce crime. June vivait derrière un masque, mais Carl avait vu ce qu’il cachait.
Il aimait beaucoup June, seulement il savait que c’était dû en grande partie au fait qu’elle lui donnait le sentiment d’être un héros, en raison de sa dépendance émotionnelle. June avait prétendu un jour qu’il procurait une impression de sécurité aux femmes meurtries. Elle lui avait dit que, grâce à lui, elle arrivait à dormir sans faire de cauchemars pour la première fois de sa vie. Elle disait toujours ce genre de choses lorsqu’elle était allongée et qu’elle le regardait de ses grands yeux bruns. Tant qu’ils étaient allongés, la relation était divine. Il en allait autrement dès que June se relevait : elle changeait du tout au tout. Cela se terminait toujours mal, mais c’est le cas pour tous ces types de relations.
Elle se sépara du groupe et se fraya un chemin dans la foule en poussant les uns et les autres. Elle souriait de toutes ses parfaites dents blanches et agitait les bras en s’approchant de Carl. Les gens debout près de lui s’éloignèrent pour éviter d’être frappés par ses mains en mouvement. June enlaça Carl de ses bras ornés de bracelets et l’embrassa sur les deux joues. Elle portait une robe flottante et brillante au dos très échancré qui révélait le haut de ses fesses. Peut-être y avait-il des soldes, se dit Carl, se souvenant de la robe portée par la jeune Russe au club. Quand June se pencha pour l’embrasser, il vit tout, jusqu’à son petit string et ses fesses nues.
— Carl, mon salaud, où étais-tu ? J’avais peur que les gangsters aient eu ta peau, dit-elle en parfait anglais.
— Pas les gangsters, c’est la police qui m’a eu, répondit-il dans le brouhaha.
— C’est pire ! Tu plaisantes, non ?
— Oui, je plaisante. Je ne me suis pas fait avoir encore.
— Tu devrais être prudent. Je me tracasse pour toi en permanence, dit-elle en fronçant les sourcils, ce qui lui creusa des fossettes dans les joues.
— Comment vas-tu ? lui demanda Carl.
— Je suis folle furieuse, espèce de sale type. Où étais-tu toute cette année passée ? Je me suis sentie si seule.
Elle ponctua sa phrase d’un coup de poing dans la poitrine de Carl.
— J’ai entendu dire qu’un vieux Hongrois t’avait acheté des diamants et embarquée sur des vols en première classe vers Paris et Londres pour de longs weekends.
— Que veux-tu que je fasse ? Tu ne m’épouseras jamais, dit-elle en faisant la moue.
— C’est l’histoire de toute ma vie, June ; j’aime avoir des amis riches, mais je n’en ai pas vraiment les moyens.
Elle s’était rapprochée de lui au fur et à mesure de la conversation pour s’assurer que Carl l’entende malgré la musique ambiante. Il sentit son haleine tiède lui frôler le cou et ses seins se presser contre lui.
— Sortons d’ici, lui murmura-t-elle en plein dans l’oreille.
Elle dit au revoir à ses amies pendant que Carl payait la note. Curieusement, ses cocktails au champagne avaient été imputés sur la note de Carl sauf qu’elle n’avait pas été près de lui lorsqu’elle les avait sirotés. Carl s’était toujours demandé comment elles arrivaient à se révéler si efficaces dans un pays où changer une ampoule prenait une semaine. Ils sortirent par la porte arrière bien que ce n’ait pas été vraiment nécessaire. Carl prit cette sortie-là, car elle était toujours ravie de montrer aux gens qu’il était différent.
Ils allaient chez Carl en voiture. Les routes étaient désertes et Bangkok un chouette endroit où se trouver au petit matin. Si vous pouvez rentrer chez vous à 4 heures du matin et ne jamais sortir avant 10 heures le soir, alors Bangkok est probablement l’endroit idéal pour vivre. Les routes désertes et l’air de la nuit plus frais rendaient la balade en Porsche très agréable. Le moteur à refroidissement par air ronronnait et vrombit dans Sukhumvit Road. Toutes les nanas adoraient être passagères de la Porsche rouge.
June avait enlevé ses chaussures et glissé ses pieds sous ses fesses. Sa tête, posée sur le bras gauche de Carl, sautait à chaque changement de vitesse. Carl voyait tout à l’intérieur de sa robe et ça avait l’air bien. C’était beau, confortable et chaud. Ils avaient été bien ensemble, autrefois, pendant un certain temps. […]
Un ebook offert !
Dernières parutions
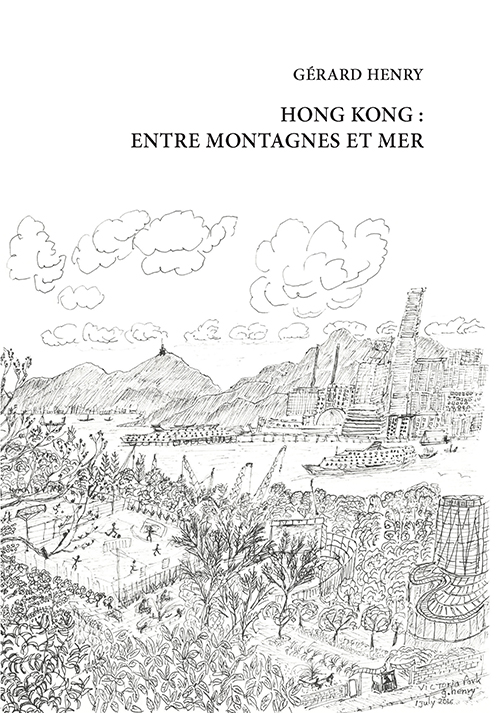
A pour Aide-ménagère, B pour beauté Chinoise, C pour saison des Crabes… découvrez le Hong Kong d’hier et d’aujourd’hui avec Gérard Henry !

Explorez les îles indonésiennes et rencontrez leurs étranges habitants en suivant les chemins ouverts par Thierry Robinet !

Une histoire... ordinaire comme l’individualisme, le manque de compassion et de solidarité dans cette Thaïlande qui s’urbanise, se modernise.

Maison d’édition indépendante ayant pour vocation de faire découvrir la Thaïlande, Hong Kong, la Malaisie, l'Indonésie, le Cambodge... par le livre

